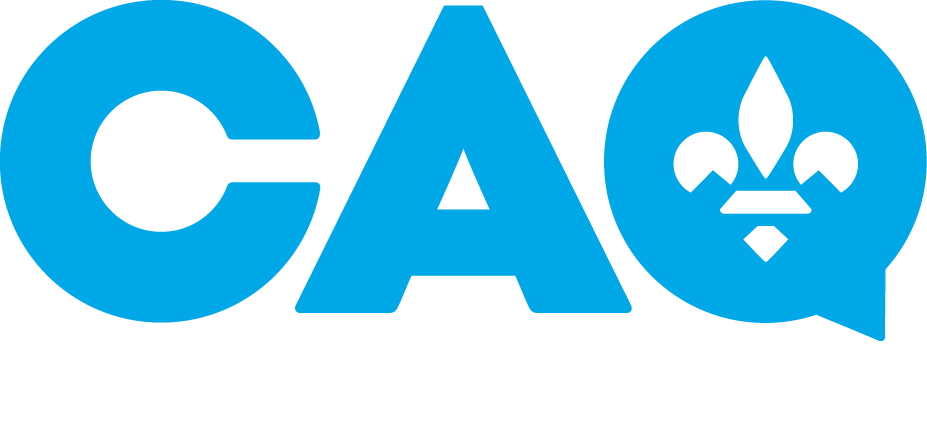Moissonneurs Solidaires : près 900 000 $ pour faire pousser l’espoir et l’entraide
Publié le 2 septembre 2025

Pour améliorer l’accès à une alimentation saine et renforcer les capacités du milieu communautaire, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, accorde 884 642 $ à Moissonneurs Solidaires. Cet investissement s’inscrit dans l’objectif du Plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale visant à soutenir des initiatives concrètes qui répondent aux besoins réels des personnes vulnérables.
Depuis plusieurs années, Moissonneurs Solidaires se distingue par son engagement à rendre les aliments frais plus accessibles aux personnes en situation de pauvreté. En développant une solution d’approvisionnement en légumes pour les banques alimentaires, l’organisme contribue à promouvoir une alimentation saine et de proximité. Ses activités agricoles agissent aussi comme un levier d’inclusion, en offrant des possibilités concrètes de réinsertion sociale qui sous-tendent la lutte contre la pauvreté.
Grâce à ce financement, l’organisme pourra lancer une nouvelle serre et développer des activités éducatives et communautaires qui encouragent de saines habitudes alimentaires et le partage des savoirs. De plus, Moissonneurs Solidaires entend développer une nouvelle offre durable de légumes frais afin de soutenir les activités du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) et du Club des petits déjeuners. L’organisme investira plus de 200 000 $ dans ce projet, dont le budget total dépasse 1,1 million de dollars.
Citations
« Avec Moissonneurs Solidaires, on voit concrètement comment une idée bien ancrée sur le terrain peut transformer des vies. Ce n’est pas juste de l’aide alimentaire, c’est une façon nouvelle d’agir, ensemble, pour repenser notre manière de nourrir les communautés et avoir un impact réel sur le quotidien des personnes les plus vulnérables. Ce projet s’inscrit pleinement dans notre stratégie, qui vise à aller au-delà de l’achat de denrées pour les réseaux que nous soutenons. Ce genre d’initiative inspire, donne espoir, et ouvre la voie à une société plus juste et inclusive. »
Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire
« Je suis heureuse de l’octroi de ce montant à Moissonneurs Solidaires. L’organisme pourra poursuivre sa mission et les activités de sa ferme dans la municipalité de Lotbinière et ainsi encore mieux répondre aux besoins grandissants en alimentation des personnes vulnérables. C’est une excellente nouvelle pour la région et pour toute la province. »
Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac
« Moissonneurs Solidaires étant, depuis sa création en 2007, un partenaire de premier plan du réseau des BAQ, c’est avec joie et reconnaissance que nous avons accueilli la réponse du Ministère à notre demande de financement qui permettra de mettre en place des actions additionnelles visant à augmenter la capacité d’agir eu égard au phénomène de l’insécurité alimentaire. »
Ronald Lussier, directeur général de Moissonneurs Solidaires
Faits saillants
- Le financement accordé à l’organisme s’inscrit dans la mesure 2.1.1.5 – Bonifier le soutien financier à des initiatives porteuses en matière de sécurité alimentaire du Plan de lutte.
- La mesure 2.1.1.5 du Plan de lutte vise à soutenir des initiatives porteuses qui engendreront des résultats positifs en matière d’aide alimentaire. Un budget de 4 M$ sur cinq ans est prévu.
- Le projet présenté par Moissonneurs Solidaires permettra de :
- mettre en place des activités de semis pour la production à grande échelle de nouveaux légumes qui seront distribués dans le réseau des BAQ;
- produire en serre des légumes variés pour le réseau des BAQ et le Club des petits déjeuners;
- organiser des ateliers et des conférences de sensibilisation entourant les enjeux de sécurité alimentaire, d’agriculture urbaine, des saines habitudes de vie et du développement durable;
- renforcer la lutte au gaspillage alimentaire par l’augmentation de la récupération de denrées fraîches qui ne correspondent pas au standard de l’industrie alimentaire pour les distribuer dans le réseau des BAQ.
- Par rapport à la saison 2024, sur une période de cinq ans, le projet de mise en opération des activités serricoles devrait permettre à l’organisme d’accroître de 50 % sa distribution de légumes frais au profit du réseau des BAQ.