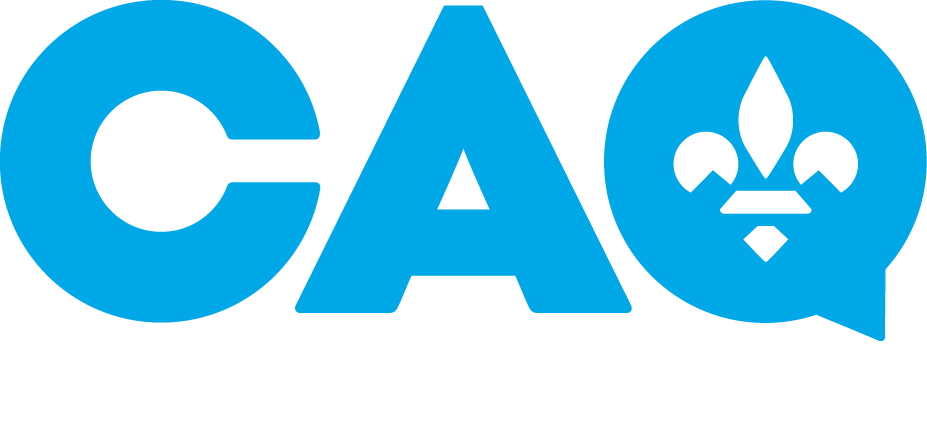Investissement de 1,2 G$ US de Québec et d’Airbus dans la Société en commandite Airbus Canada
Publié le 4 février 2022

Le gouvernement du Québec et Airbus investissent conjointement 1,2 milliard de dollars américains en tant qu’actionnaires dans le capital de la Société en commandite Airbus Canada (Airbus Canada) afin de soutenir l’accélération de la cadence de production des avions A220, compte tenu du solide carnet de commandes de l’entreprise. La principale chaîne d’assemblage finale ainsi que le centre d’excellence et névralgique du programme A220 sont situés à Mirabel, dans la région des Laurentides. En proportion de l’actionnariat existant, Québec investira 300 millions de dollars américains, par l’entremise d’Investissement Québec, tandis qu’Airbus investira 900 millions de dollars américains, conformément aux précédentes prévisions de son plan d’affaires. Cet investissement contribuera au maintien de l’équivalent de 2 500 emplois à temps plein et qualifiés dans le secteur de l’aéronautique au Québec et permettra d’atteindre la maturité du programme, en plus de créer de nouveaux emplois.
Le premier ministre du Québec, M. François Legault, en a fait l’annonce aujourd’hui en compagnie du ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon.
Cet investissement est accompagné d’une série d’engagements d’Airbus en matière d’emplois et de maintien de la production afin de s’assurer que les retombées économiques générées augmentent et profitent à l’économie du Québec.
L’investissement gouvernemental permettra également de repousser la date de rachat de la participation de Québec, prévue initialement en 2026, jusqu’à quatre (4) années additionnelles, en 2030, ce qui donnera du temps à Airbus Canada pour créer davantage de valeur au programme A220.
« L’annonce d’aujourd’hui est importante pour notre industrie aérospatiale. On va investir 300 millions de dollars américains dans le programme A220 d’Airbus. Ça va permettre de protéger 2 500 emplois bien payés à Mirabel. Airbus est un bon partenaire pour le Québec. L’entreprise a continué de miser sur le génie québécois pour bâtir l’un des avions les plus prometteurs au monde. »
François Legault, premier ministre du Québec
« Cet investissement du gouvernement, à la hauteur de son actionnariat, renforce la position du Québec dans son partenariat avec Airbus. On obtient des engagements à plus long terme et on a de meilleures chances de récupérer notre investissement initial, incluant le montant de 1 milliard de dollars américains. Nous sommes fiers de collaborer avec Airbus, qui joue maintenant un rôle clé dans notre écosystème aérospatial, et nous espérons qu’elle sera ici pour longtemps. »
Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional
« L’industrie aéronautique mondiale démontre depuis quelques mois des signaux de reprise. Les avions monocouloirs, incluant l’A220 conçu et assemblé à Mirabel, sont les premiers à se remettre des contrecoups de la pandémie. D’ailleurs, nos récentes annonces de commandes d’A220 et les chiffres de livraison pour 2021 en témoignent. L’A220 a un solide carnet de commandes, avec près de 500 avions à livrer au cours des prochaines années. Nous croyons fermement à l’avenir de l’A220, un avion des plus avancés technologiquement, qui est déjà reconnu par nos clients pour sa performance et son empreinte carbone réduite. Comme annoncé précédemment, en tant qu’actionnaire majoritaire du programme, Airbus continue d’investir dans le partenariat et au Québec afin d’accélérer la cadence mensuelle de production des avions A220 pour ainsi assurer le succès anticipé du programme au milieu de la décennie. »
Guillaume Faury, président-directeur général d’Airbus
Faits saillants :
- Airbus Canada emploie l’équivalent de 2 500 personnes à temps plein au Québec. Selon la cadence de production prévue, le nombre d’effectifs pourrait se chiffrer à 3 000 en 2025 et engendrer des retombées économiques bénéfiques.
- Airbus détient 75 % des parts de la Société en commandite et le gouvernement du Québec 25 %.
Ministère de l’Économie et de l’Innovation sur les réseaux sociaux :