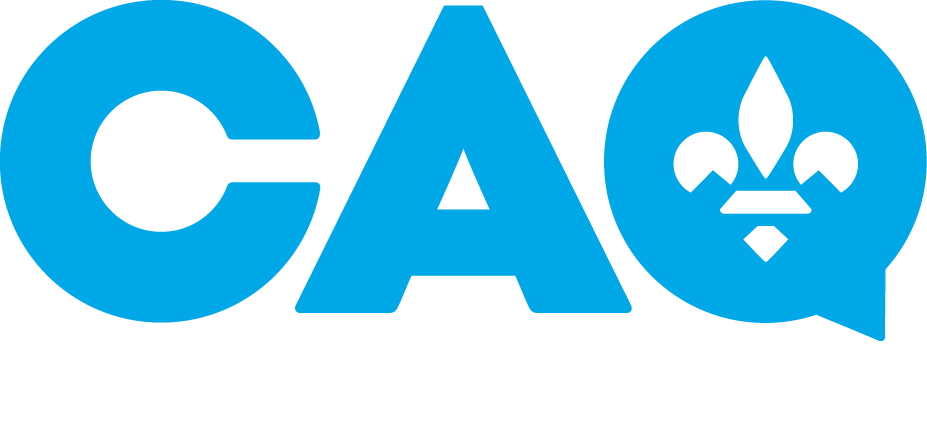Le ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, a profité de sa participation au congrès international de la Biotechnology Innovation Organization (congrès BIO) à Boston afin de confirmer des investissements de plus de 6 millions de dollars pour appuyer le secteur québécois des sciences de la vie.
Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM)
Le gouvernement soutient deux projets innovants dans le domaine de l’ARN par l’entremise d’un financement de plus de 700 000 $ octroyé par le CQDM dans le cadre du programme SynergiQc.
Le premier est mené par le professeur Sébastien Tremblay de l’Université Laval en collaboration avec le CQDM, la Fondation Brain Canada et les entreprises ARN Technologies & Thérapeutiques et CereCura Nanotherapeutics. Il vise à développer une nouvelle technologie à base d’ARN pour induire la production de protéines thérapeutiques dans le cerveau. Le deuxième, réalisé par le professeur Frédéric Couture de TransBIOTech de concert avec l’entreprise Feldan Thérapeutiques, permettra de mettre au point et d’évaluer une nouvelle technologie pour le traitement des maladies respiratoires. La valeur de ces deux projets est estimée à plus de 2,5 millions de dollars.
L’ouverture du pavillon du Québec a aussi marqué le lancement d’un programme de financement pour soutenir l’innovation en thérapies à ARN. L’objectif est d’appuyer les entreprises québécoises dans le développement de technologies afin de renforcer la compétitivité dans ce secteur en pleine expansion. Le programme sera géré par le CQDM par l’entremise d’AReNA, le pôle ARN du Québec, avec un financement gouvernemental de 3 millions de dollars dans le cadre de l’initiative ARN annoncée l’an dernier.
Médicament Québec
Le gouvernement accorde aussi plus de 2,4 millions de dollars à deux projets de recherche par l’entremise de Médicament Québec.
Le premier, dirigé par le professeur Jorg Fritz de l’Université McGill en partenariat avec les entreprises NovoArc, MHL Consultation technique et recherche et ARN Technologies & Thérapeutiques, concerne la création d’une plateforme collaborative pour tester de nouveaux vaccins à ARN. Le deuxième, mené par Xavier Banquy de l’Université de Montréal en collaboration avec les entreprises Lipoid, Flowid et ARN Technologies & Thérapeutiques, vise le développement d’une nouvelle technologie de production biopharmaceutique.
Ces projets contribueront à la croissance de la filière ARN du Québec et à la formation de personnel hautement qualifié, renforçant ainsi les compétences et le savoir-faire au sein de l’écosystème québécois.
Partenariats et collaborations
Le gouvernement a aussi souligné la mise en place de nombreux partenariats prometteurs pour l’essor du secteur québécois des sciences de la vie. Tout d’abord, le centre collégial de transfert de technologies TransBIOTech et les Services experts Molecular Forecaster ont uni leur expertise pour accélérer la découverte de nouveaux médicaments au Québec et au-delà.
L’entente de collaboration entre la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé du grand Montréal, Montréal InVivo, et Osaka Bio Headquarters, situé au Japon, est un autre partenariat stratégique qui a été soulevé. Elle viendra enrichir le secteur des sciences de la vie, tant au Québec qu’au Japon, grâce au partage de connaissances et d’initiatives.
Deux autres ententes, signées par BIOQuébec, ont aussi été mises en lumière. La première, en partenariat avec Life Sciences British Columbia, a pour but de renforcer le secteur des sciences de la vie au Canada. La deuxième s’est faite avec la Bioscience Association Manitoba, toujours dans le but de faire avancer ce créneau stratégique. Ces initiatives visent à bâtir un écosystème canadien plus connecté, en misant sur le partage de l’expertise, des ressources et des réseaux, au bénéfice des membres des deux organisations et du rayonnement de l’industrie.
Citations :
« Le Québec est à l’avant-garde dans le domaine des sciences de la vie, et c’est une fierté de soutenir toutes ces innovations et de développer une filière industrielle forte en ARN au Québec. Je félicite les entreprises, les équipes de recherche et les organismes qui contribuent au rayonnement de ce secteur stratégique pour notre économie. Leurs initiatives démontrent clairement l’excellence de notre écosystème. On l’a encore une fois constaté au congrès BIO 2025. »
Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval
« En soutenant, dès les premiers stades, les projets innovants dans le domaine prometteur des thérapies à ARN, nous contribuons activement à créer de la valeur pour le Québec, sur le plan tant scientifique qu’économique, tout en renforçant notre position dans un secteur stratégique pour l’avenir de la santé. De plus, le lancement du programme de financement destiné aux entreprises biopharmaceutiques québécoises témoigne de la vision du gouvernement du Québec, qui est résolument engagé à appuyer cette industrie et à stimuler son pouvoir d’innovation. En les accompagnant à chaque étape clé du développement de leurs innovations, cette initiative participera concrètement à la commercialisation de procédés, de produits et de services technologiques favorisant l’essor des thérapies à ARN au Québec et elle jouera un rôle structurant dans le renforcement de cette filière d’avenir. »
Véronique Dugas, présidente et directrice générale du CQDM
« Médicament Québec est fière d’unir ses forces avec celles des partenaires du collectif la CELLULE afin de contribuer au développement de la filière ARN du Québec. Les nouveaux vaccins et médicaments à ARN ont besoin de véhicules adaptés. Leur fabrication industrielle sera facilitée par les technologies de production innovantes appuyées par le numérique et mises au point par l’équipe du Pr Banquy. De plus, la plateforme du Pr Fritz permettra d’explorer des voies d’administration alternatives de vaccins sans avoir recours aux aiguilles, grâce à des formulations novatrices conférant une protection immunitaire plus longue contre les pathogènes émergents. »
Arianne Trudeau, directrice de Médicament Québec
« En intégrant les capacités des Services experts Molecular Forecaster à notre offre, nous renforçons notre soutien aux entreprises qui développent de nouveaux médicaments. Ce partenariat stratégique nous permettra de proposer une chaîne complète et intégrée de services allant de la modélisation moléculaire à la validation préclinique. »
Delphine Davan, directrice des partenariats et du développement des affaires de TransBIOTech
« Nous sommes ravis d’amorcer cette collaboration avec TransBIOTech, qui va nous permettre de relier efficacement les résultats issus de la modélisation computationnelle à des données expérimentales tangibles. En complément de nos autres partenariats pour les expériences biophysiques, comme celui avec Recherche et solutions NMX – une autre entreprise québécoise -, cette synergie va considérablement enrichir notre offre de services et accélérer les cycles de développement pour nos clients au Québec et au-delà. »
Joshua Pottel, fondateur et président-directeur général des Services experts Molecular Forecaster
« Montréal InVivo est fier de signer un protocole d’entente avec Osaka Bio Headquarters, un acteur clé du développement des sciences de la vie au Japon. Ce partenariat marque le début d’une collaboration stratégique entre deux régions à fort potentiel qui partagent une vision commune : faire de l’innovation un levier de croissance et de bien-être pour nos communautés. »
Stéphanie Doyle, présidente-directrice générale de Montréal InVivo
« Ces partenariats interviennent à un moment où il est plus important que jamais de renforcer les liens qui existent déjà au sein de l’écosystème des sciences de la vie au Canada. Nos membres, souvent actifs dans tout le pays, s’attendent à ce que les associations industrielles qui les représentent montrent l’exemple et qu’elles travaillent ensemble pour maximiser les retombées de ces collaborations. En réunissant nos forces avec celles de la Colombie-Britannique et du Manitoba, nous jetons les bases d’une fondation plus solide pour l’innovation dans le domaine des sciences de la vie à l’échelle du Canada. »
Benoît Larose, président-directeur général de BIOQuébec
« La capacité du Canada à être compétitif sur la scène mondiale dans le domaine des sciences de la vie dépend d’une collaboration solide et stratégique entre les provinces. Ce protocole d’entente reflète un engagement commun à bâtir un écosystème mieux connecté qui favorise l’innovation, soutient le développement économique et contribue à faire progresser nos priorités en matière de soins de santé. »
Wendy Hurlburt, présidente-directrice générale de Life Sciences British Columbia
« Une approche pancanadienne est essentielle pour l’avenir de notre industrie. Ce nouveau protocole d’entente avec BIOQuébec reflète un engagement commun à soutenir l’innovation, à renforcer les écosystèmes des sciences de la vie du Manitoba et du Québec et à créer de nouvelles occasions. En unissant nos efforts, nous pouvons mieux harmoniser nos ressources, amplifier notre effet et bâtir un avenir plus fort pour les sciences de la vie au Canada. »
Andrea Ladouceur, présidente-directrice générale de Bioscience Association Manitoba
Faits saillants :
- L’industrie québécoise des sciences de la vie regroupe 753 entreprises, qui emploient plus de 39 000 personnes, et plusieurs grandes multinationales dans les secteurs biopharmaceutique et du matériel médical.
- La délégation québécoise présente au congrès BIO compte plus d’une cinquantaine d’entreprises, d’organismes de recherche et de partenaires de l’industrie, totalisant une centaine de participants. La mission est organisée par Investissement Québec International en collaboration avec la Délégation du Québec à Boston et le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie. Cet événement est le plus important rendez-vous annuel international du secteur biopharmaceutique.