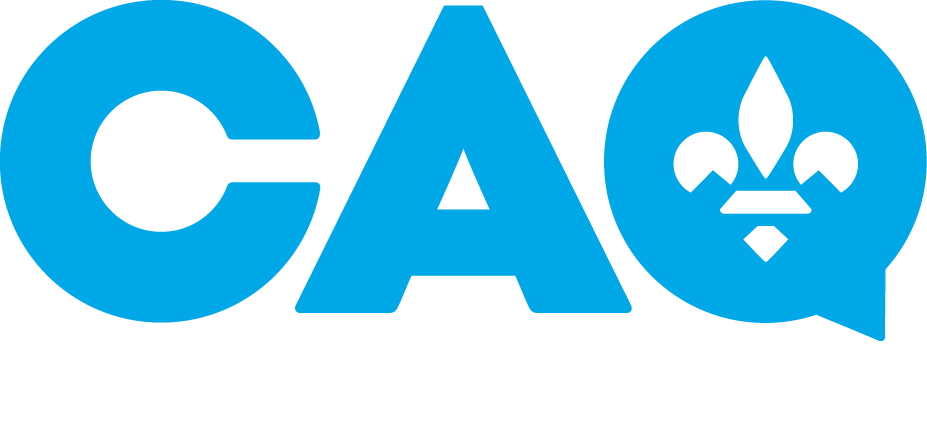Pour faire face aux besoins de main-d’œuvre de l’industrie touristique, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, s’unissent à l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (Alliance), aux associations touristiques et au Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) pour présenter des initiatives totalisant des investissements de 2,5 millions de dollars.
« À l’occasion de ma tournée de consultation, je rencontre des représentants de centaines d’entreprises qui font face à des défis de plus en plus grands en matière de main-d’œuvre. Le tourisme est un secteur important du développement économique québécois. C’est pourquoi mon collègue Jean Boulet et moi-même n’avons pas tardé à mettre en place des actions qui aideront concrètement les entreprises. Les chercheurs d’emploi et les étudiants qui font actuellement leur choix de carrière doivent savoir que de nombreux métiers sont offerts en tourisme. Ceux-ci pourraient leur permettre de se réaliser professionnellement et d’aspirer à une longue carrière dans un secteur stimulant et valorisant. », a annoncé Caroline Proulx, ministre du Tourisme.
La rareté de la main-d’œuvre constitue un enjeu majeur pour les entreprises touristiques de l’ensemble de la province. Ce phénomène s’explique entre autres par un nombre décroissant de jeunes disponibles, des départs à la retraite dans les tranches d’âge plus élevées, la saisonnalité des emplois et les conditions de travail difficiles.
Campagne de valorisation
Afin d’attirer la main-d’œuvre, la ministre du Tourisme annonce une importante campagne de valorisation des métiers du tourisme. Cette dernière comprend des activités de relations publiques printanières afin de consolider la position du tourisme en tant que secteur d’emploi dynamique. Cette première démarche, orchestrée de concert avec l’Alliance et le CQRHT, a pour objectif de donner un coup de pouce aux PME touristiques en plein cœur de leur période d’embauche pour les emplois saisonniers et occasionnels d’été. Une grande campagne promotionnelle visera également à mieux faire connaître les métiers de ce secteur d’activité.
En appui à ces engagements en matière de promotion et de valorisation, une stratégie d’accompagnement des PME sera mise en branle afin d’aider celles-ci à améliorer leur compétitivité au regard des emplois offerts.
Coup de pouce au secteur de la restauration
Le secteur de la restauration est particulièrement touché par les difficultés de recrutement. Pour atténuer les répercussions de la rareté de la main-d’œuvre dans ce secteur, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale annonce la mise en place d’un programme de formation de courte durée pour former des aides-cuisiniers dans neuf régions du Québec.
« La rareté de la main-d’œuvre fait en sorte que nous devons tous revoir nos façons de faire pour permettre aux entreprises et à l’économie du Québec de poursuivre leur croissance. La mise en place du programme de formation de courte durée pour former des aides-cuisiniers démontre que les intervenants du marché du travail peuvent se concerter pour offrir des solutions sur mesure en vue de répondre aux besoins de main-d’œuvre. Je suis convaincu que ce projet aura des retombées bénéfiques pour le secteur touristique. », a déclaré Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.
Ce programme vise à attirer de la main-d’œuvre éloignée du marché du travail (immigrants, personnes expérimentées, handicapées, etc.) en lui offrant de la formation de courte durée sous forme de stage menant à une attestation d’études professionnelles en cuisine de restauration rapide. Se déroulant sur trois ans, il permettra de pourvoir 90 postes, par exemple serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien, dans le même nombre d’entreprises.
Notons que le programme, dont le coût se chiffre à 1 140 453 $, débutera en mai 2019. Il sera coordonné par le CQRHT.
« En nous appuyant sur des données ressortant d’une enquête récente effectuée auprès des travailleurs de notre industrie, nous sommes confiants que les actions de valorisation qui seront déployées et que les diverses stratégies mises de l’avant auprès des PME en matière de pratiques de ressources humaines permettront aux entreprises d’être plus attrayantes sur le marché de l’emploi et de fidéliser les travailleurs, sans qui le produit touristique du Québec n’aurait pas la notoriété actuelle. », a indiqué Lucie Charland, présidente, Conseil québécois des ressources humaines en tourisme.
« La population locale et le savoir-être de la main-d’œuvre sont déterminants dans la qualité de l’expérience touristique. Le facteur humain est celui qui forge la personnalité unique du Québec et qui lui donne tout son charme en tant que destination de calibre mondial. Il s’agit là d’un avantage concurrentiel indéniable. Les investissements et les actions annoncés aujourd’hui viennent aider concrètement les entrepreneurs de l’industrie à offrir une prestation de services à la hauteur de la promesse offerte par la marque QuébecOriginal. », a souligné Martin Soucy, président-directeur général, Alliance de l’industrie touristique du Québec.
Faits saillants :
- La campagne annoncée comprend une première phase de relations publiques orchestrée par l’Alliance et le CQRHT dès ce printemps, pour un investissement de 100 000 $.
- Dans un second temps suivra une offensive de communication, dans laquelle l’Alliance, le CQRHT et leurs partenaires associatifs ainsi que le ministère du Tourisme injecteront 650 000 $.
- Un montant de 335 000 $ sera investi par les partenaires associatifs et le ministère du Tourisme pour améliorer la compétitivité des PME de l’industrie touristique, attirer les talents et augmenter la rétention dans ce secteur d’activité.
- Le CQRHT offre une contribution supplémentaire de 300 000 $ pour la coordination des actions des partenaires de même que pour le développement d’outils en appui à cette démarche.
- Le tourisme, de manière générale, est en croissance au Québec et continuera de l’être pendant plusieurs années. Au cours de l’année 2018, les recettes touristiques ont atteint près de 15,7 milliards de dollars, une hausse de 4,9 % par rapport à 2017.
- Cette croissance a des répercussions évidentes sur la demande d’emploi dans les différents secteurs. À titre d’exemple, en 2018, au moins 3 % de tous les postes des principaux secteurs touristiques étaient vacants, signe que la rareté de main-d’œuvre se faisait déjà sentir.
Au Québec, ce sont quelque 400 000 emplois qui sont associés au tourisme.
- M. Boulet visite toutes les régions du Québec afin de rencontrer les partenaires du marché du travail pour, notamment, leur faire part de sa vision des actions à poser afin de soutenir les entreprises devant conjuguer leurs besoins avec la rareté de la main-d’œuvre et leur faire connaître les programmes, mesures et services du MTESS en matière de développement des compétences, de gestion des ressources humaines et d’aide au recrutement. Il a commencé sa tournée du Québec le 4 février, à Trois-Rivières.
Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :
https://twitter.com/tourisme_quebec/
https://www.facebook.com/TourismeQc/
https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/
https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw