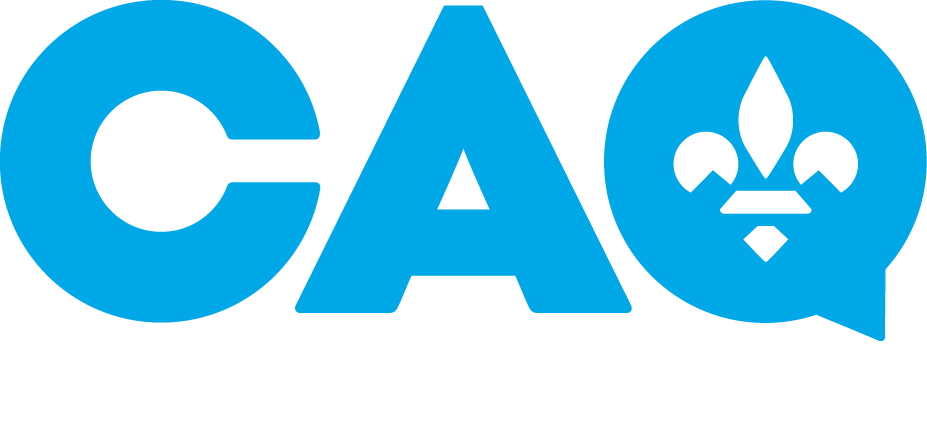La Financière agricole du Québec dresse le portrait de la saison de végétation et des interventions du Programme d’assurance récolte de la dernière année pour la région de la Montérégie. Ainsi, en 2018, 3 070 entreprises agricoles de cette région étaient assurées pour des valeurs représentant plus de 565 millions de dollars. De ce nombre, 989 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 12,2 millions de dollars, dont plus de 4,5 millions de dollars pour le foin et les pâturages et plus de 3,6 millions de dollars pour les cultures maraîchères.

Bilan de fin de saison en assurance récolte (Groupe CNW/La Financière agricole du Québec)
Portrait 2018
Hiver
Bonnes conditions hivernales pour la survie des luzernières, des céréales d’automne et des pommiers, mais dommages observés dans plusieurs fraisières et dans les jeunes vergers en implantation
Survie des abeilles difficile et pertes hivernales dans les ruches
Printemps
Sirop d’érable : rendement et qualité supérieurs à la moyenne
Printemps tardif avec températures fraîches et précipitations abondantes en avril et début mai
Belle période de semis en mai dans de très bonnes conditions de terrain, et conditions climatiques propices à l’émergence et au développement des cultures en juin
Été
Saison estivale caractérisée par des températures très chaudes et peu de précipitations surtout en juillet et août
Fraises : rendements et qualité inférieurs à la moyenne, plusieurs champs affectés par le gel hivernal, le manque d’eau et l’excès de chaleur du début juillet
Foin : rendements inférieurs à la moyenne dus au manque de précipitations
Pommes : récolte globale légèrement sous la normale, qualité moyenne malgré le manque de coloration et petit calibre des fruits dans plusieurs vergers
Cultures maraîchères et légumes de transformation : sécheresse ayant affecté le calibre des légumes et les rendements des cultures, et excès de chaleur ayant accéléré le mûrissement de plusieurs légumes
Automne
Automne frais et très pluvieux, suivi de neige hâtive causant du retard dans les récoltes et les travaux aux champs de fin de saison.
Céréales et maïs-grain : rendements très variables, inférieurs à supérieurs à la moyenne selon les secteurs. Rendements de soya, en général supérieurs à la moyenne
Globalement, les rendements ont été très variables selon les cultures, les secteurs et le moment des récoltes
De façon générale, l’ouest de la Montérégie a été plus affecté que l’est de la Montérégie
« L’agriculture est un secteur important de notre économie, principalement pour les régions du Québec. La Financière agricole assure un soutien important aux agriculteurs, permettant ainsi de maintenir leur secteur compétitif et durable lorsque des aléas climatiques se présentent. », a annoncé M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
« Ce bilan présente un portrait de l’état des cultures au Québec et des impacts climatiques sur celles-ci. Dans un contexte où les conditions peuvent se montrer défavorables, La Financière agricole procure une stabilité aux entreprises agricoles avec les différents outils de gestion des risques qu’elle met à leur disposition. », a déclaré M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec.
« La Financière agricole joue un rôle important quant à la pérennité des entreprises agricoles. Grâce à l’intervention du Programme d’assurance récolte, les agriculteurs de notre région peuvent protéger leurs productions. », a souligné Mme Sonia Simard, directrice territoriale.
La Financière agricole du Québec
Offre des produits et des services de qualité en matière de financement, d’assurance et de protection du revenu
Favorise le développement et la stabilité de plus de 24 000 entreprises agricoles et forestières québécoises
Place la relève agricole au cœur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité
Participe activement à l’essor économique du Québec et de ses régions : des valeurs assurées s’élevant à 3,9 milliards de dollars et un portefeuille de garanties de prêts atteignant 5,3 milliards de dollars
Liens connexes
Bilan de l’assurance récolte pour l’année 2018
Site Web de la FADQ
Autres liens connexes:
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2704110414
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2704118510
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2704110914
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2704110023
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2704114788
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2704115396
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2704111845
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2704111995
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2704112953
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2704116766
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2704110620
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2704119190
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2704115956
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2704113077