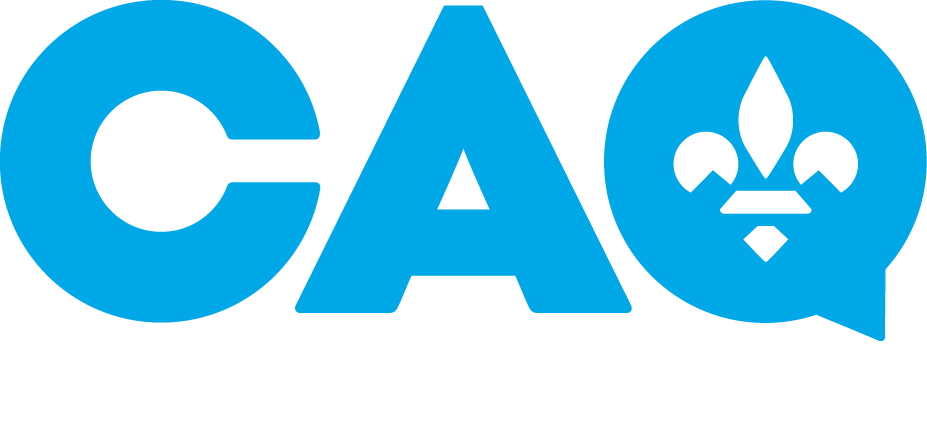Mobilisation pour les journaux communautaires d’expression anglaise
Publié le 7 juin 2019

À l’occasion de la relance du journal local de langue anglaise The Gleaner, le gouvernement du Québec a exprimé sa préoccupation par rapport aux difficultés que connaissent les journaux locaux de langue anglaise, tout comme l’ensemble des médias écrits. Il avait déjà montré sa détermination à soutenir la survie et l’essor de ces journaux, qui ont un rôle particulièrement rassembleur, dans les communautés d’expression anglaise, et ce, par l’attribution, en décembre dernier, d’un soutien de 118 000 $ à la Quebec Community Newspaper Association (QCNA). Cette somme devait permettre à l’organisme de réaliser une étude portant sur la situation des médias locaux de langue anglaise du Québec. Cette étude a pour but de mieux cerner les enjeux du secteur, en vue de déterminer les solutions visant à y remédier.
Avec la somme accordée, sur une période de quinze mois, en provenance du Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise (SRQEA), la QCNA, un organisme consacré au développement des communautés et des médias d’expression anglaise, a le mandat de produire une étude concernant l’incidence des médias locaux sur les régions éloignées ainsi que les communautés rurales et urbaines du territoire québécois. Cette étude permettra au secteur des médias locaux de mieux comprendre l’évolution du paysage médiatique ainsi que ses effets sur les communautés locales, dans le but d’adapter les formes de diffusion pour mieux servir ces auditoires. Elle visera à déterminer notamment ce qui se produit après la fermeture du seul média de langue anglaise, dans une communauté, et comment les journaux et les radios locales, collégiales et universitaires peuvent attirer et retenir de jeunes auditoires.
Le projet établira également des partenariats avec les médias universitaires et ceux des cégeps, qui favoriseront la création d’emplois et des occasions de stages pour les étudiantes et étudiants en journalisme. Ainsi, il contribuera également à la rétention des jeunes, dans le milieu, et à maintenir des médias locaux écrits et radiophoniques.
« Les journaux locaux sont essentiels pour renforcer le sentiment d’appartenance des lectrices et lecteurs à leur communauté. Comme c’est le cas pour l’ensemble des journaux locaux, les médias de langue anglaise connaissent des difficultés qui nous préoccupent grandement, tel qu’on l’a vu, la semaine passée, avec le Stanstead Journal. Le gouvernement du Québec a été proactif en appuyant la Quebec Community Newspaper Association, pour lui permettre de réaliser une étude sur cet enjeu. Je suis convaincu que la QCNA saura trouver des solutions efficaces pour donner un nouvel élan aux journaux locaux. Le retour du journal The Gleaner, dans la vallée de la rivière Châteauguay, nous prouve que la chose est possible. Je félicite ce regroupement, qui a pu donner une seconde vie au journal, pour le bonheur de son lectorat. », a déclaré Christopher Skeete, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d’expression anglaise.
« Il y a des journaux membres de la QCNA qui s’accrochent et qui peinent à maintenir leurs activités; qui doivent réduire leur personnel ou leur fréquence de publication afin d’éviter la fermeture. Il est primordial d’étudier les répercussions, pour une collectivité, lorsqu’un journal s’installe dans la communauté ou qu’il ferme ses portes. Le SRQEA nous soutient pour mener une telle étude, et c’est très encourageant pour les médias locaux et leur public, surtout à une époque où l’activité journalistique est en pleine transformation. », a souligné Lily Ryan, présidente par intérim de la Quebec Community Newspaper Association.
« Bien que Facebook me permette de garder contact avec mon frère, en Colombie-Britannique, et que CNN me tienne au courant de l’actualité ailleurs dans le monde, j’ai besoin de savoir ce qui se passe dans ma cour arrière. Les médias locaux sont les seuls à répondre à ce besoin. En relançant The Gleaner en tant que média appartenant à la communauté, nous avons la possibilité de fournir une information de qualité, en langue anglaise, à la population de la vallée de la Châteauguay pour les années à venir. », a indiqué Hugh Maynard, président du journal The Gleaner.