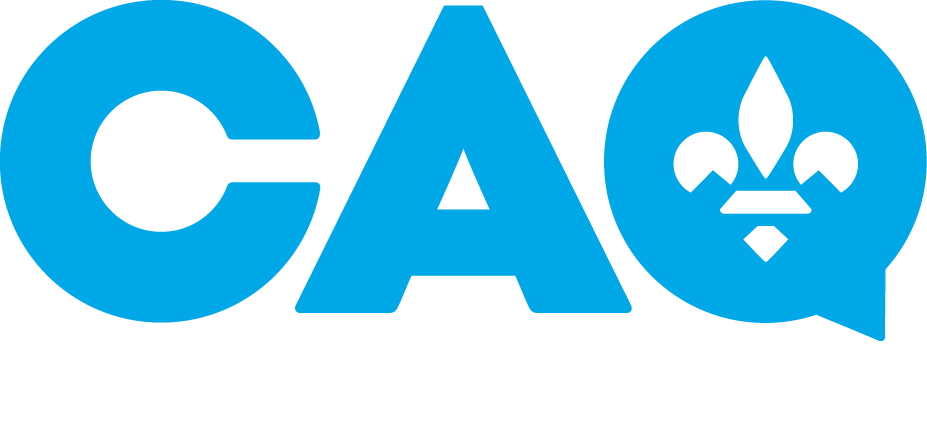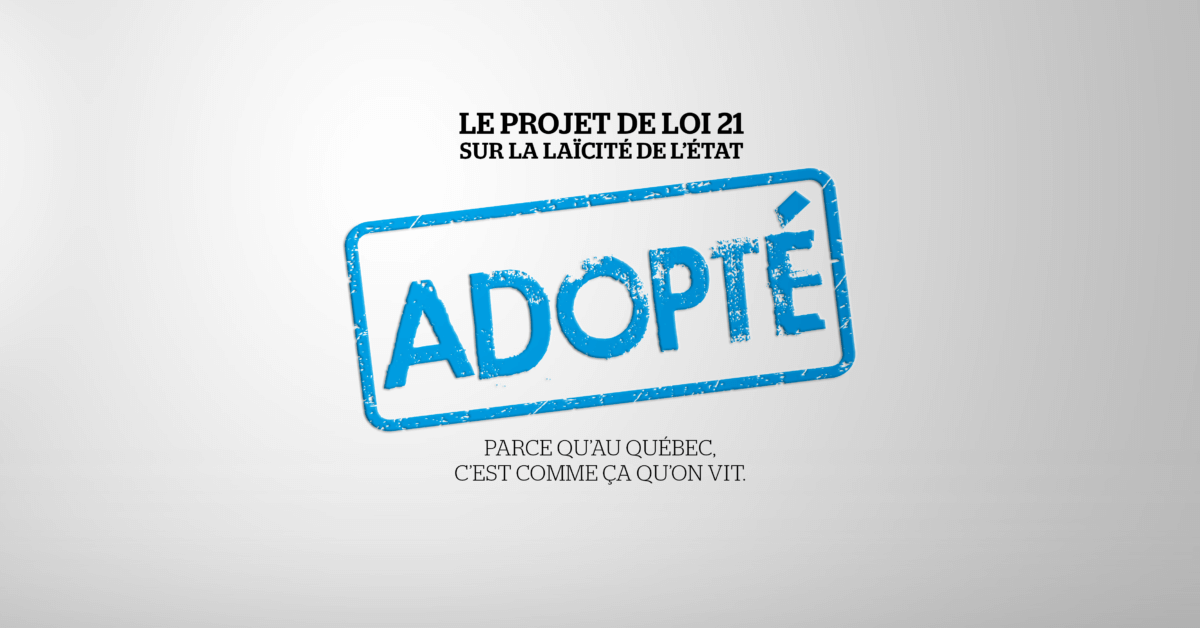À l’action pour réduire les répercussions des inondations futures
Publié le 17 juin 2019

À la suite des inondations majeures survenues ce printemps, le gouvernement du Québec entend favoriser une gestion plus rigoureuse des zones inondables. L’objectif est de limiter l’exposition des personnes et des biens à d’éventuelles inondations, tout en mettant en avant des solutions durables.
La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, et le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, ont annoncé aujourd’hui les orientations gouvernementales en ce sens.
Celles-ci consistent, entre autres, à élaborer un plan d’action en matière d’aménagement du territoire relatif aux inondations, d’ici à décembre 2019. Pour réaliser ce plan, le groupe d’action ministériel en matière d’inondations sera maintenant sous la coprésidence de la ministre Laforest et du ministre Julien. Le groupe sera complété par le ministre Charette et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau.
L’une des mesures de ce plan consiste à revoir les normes encadrant la gestion des zones inondables en vigueur pour l’ensemble du territoire afin de protéger les familles québécoises lors d’inondations.
D’ici à ce que les nouvelles normes soient mises en œuvre, le gouvernement souhaite instituer une zone d’intervention spéciale (ZIS). Cela permettrait de décréter un moratoire sur la construction et la reconstruction de bâtiments situés dans l’ensemble des zones inondables cartographiées 0-20 ans et sur le territoire qui a été inondé en 2017 et en 2019. Des dispositions particulières s’appliqueraient à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dont une grande partie du territoire a été touchée lors de la rupture de la digue (voir annexe).
« Il fallait passer à l’action afin d’atténuer les conséquences des inondations pouvant survenir dans l’avenir. Je me suis rendue sur le terrain à plusieurs reprises et je sais que le quotidien des sinistrés et des collectivités touchées a été complètement bouleversé. Il était donc important d’agir maintenant pour protéger les citoyens et leur assurer une meilleure qualité de vie à long terme. », a déclaré Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
« Notre gouvernement prend les moyens nécessaires afin de prioriser des aménagements permettant de renforcer la sécurité et la résilience de la population lors d’inondations. Pour ce faire, nous nous appuierons sur une meilleure connaissance des risques et des vulnérabilités des zones inondables. Je suis persuadé que les connaissances, le savoir-faire et l’expertise en matière de cartographie qui sont reconnus depuis plusieurs années permettront d’atteindre cet objectif. », a indiqué M. Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.
« Devant l’urgence climatique qui nous commande de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il est tout aussi essentiel de nous adapter aux conséquences des changements climatiques réelles ou appréhendées. Or, s’adapter aux phénomènes climatiques qui causent les inondations, l’un des principaux risques naturels au Québec en ce moment, c’est d’abord tout mettre en œuvre pour accorder une protection adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables de notre territoire. C’est ce que le gouvernement fait aujourd’hui en adoptant ces mesures exceptionnelles et en revoyant le cadre normatif de manière à ce que nous prévenions les dommages plutôt que nous les subissions. », a souligné M. Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Faits saillants :
- En 2019, la crue des eaux a touché quelque 250 municipalités, plusieurs milliers de résidences, en plus de forcer l’évacuation de plus de 10 000 personnes, sans compter que plusieurs routes ont dû être fermées et que des services à la population ont été durement touchés.
- Le 1er mai, le premier ministre, M. François Legault, a mis sur pied un groupe d’action ministériel en matière d’inondations. Son mandat consiste à assurer la prise en charge et l’indemnisation rapides des personnes sinistrées et à préparer le gouvernement et les acteurs concernés à faire face aux crues qui pourraient se produire en 2020.
Liens connexes :
https://www.mamh.gouv.qc.ca
Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :
facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation
twitter.com/MAMhQC/
Annexe
ZONE D’INTERVENTION SPÉCIALE
Orientations gouvernementales
- Une zone d’intervention spéciale (ZIS) est déclarée par décret, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Elle a pour but de résoudre un problème d’aménagement, dont l’urgence ou la gravité justifient une intervention.
- Dès l’adoption du projet de décret de la ZIS, la LAU prévoit une interdiction de construire, de reconstruire et de réparer un bâtiment dans les secteurs touchés. Or, il est possible d’autoriser des exceptions. En ce sens, un décret a été adopté afin d’autoriser certains travaux de réparation des bâtiments touchés par les inondations de 2019.
- Au total, 813 municipalités sont visées par la ZIS. Parmi celles-ci, 312 ont été touchées par les inondations de 2017 ou de 2019. Les autres ont été ciblées à partir des zones inondables qui ont été répertoriées par le gouvernement ou le milieu municipal et qui sont intégrées dans les outils de planification des municipalités.
Autorisation de rénover ou de reconstruire
- Les bâtiments présentant l’une des caractéristiques suivantes devraient faire l’objet d’une évaluation des dommages : l’eau a atteint le rez-de-chaussée ou les fondations doivent être remplacées ou des travaux de stabilisation doivent être effectués.
- La réparation d’un bâtiment qui n’est pas une perte totale est possible, c’est-à-dire lorsque les dommages à celui-ci sont évalués à moins de 50 % de sa valeur. Ainsi, les municipalités pourraient autoriser les travaux à cet effet.
- Les sinistrés des inondations de 2019 pourraient être admissibles au Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents du ministère de la Sécurité publique (MSP).
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
- Les inondations survenues à Sainte-Marthe-sur-le-Lac revêtent un caractère particulier, puisqu’elles ont été provoquées par la rupture de la digue.
- En ce sens, le gouvernement doit mettre en place des solutions adaptées à cette situation. Les travaux de réparation et de consolidation de la digue font partie de celles-ci.
- À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les citoyens auraient donc le droit de reconstruire un bâtiment, et ce, même si celui-ci a perdu plus de la moitié de sa valeur à neuf. Cela permettrait à ceux qui n’auraient pas pu se reconstruire, en vertu de la ZIS, de choisir s’ils veulent demeurer dans leur résidence ou déménager.
- Par contre, aucune construction ne serait permise sur les terrains qui étaient vacants au 10 juin 2019.
- Les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pourraient également être admissibles au Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents.
Consultations publiques
- Le 4 juillet prochain, le gouvernement tiendra des assemblées publiques de consultation dans les 16 régions visées par la ZIS. Les coordonnées de celles-ci sont précisées sur le site Web du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). La population pourra ainsi s’exprimer sur la démarche gouvernementale.
- Toute personne qui le souhaite pourra également déposer un avis ou un mémoire au zis2019@mamh.gouv.qc.ca, avant la tenue des consultations.
- La ZIS entrera en vigueur au moment de la publication du décret dans la Gazette officielle du Québec. Des modifications pourraient être apportées à la suite des consultations, avant l’adoption de la ZIS