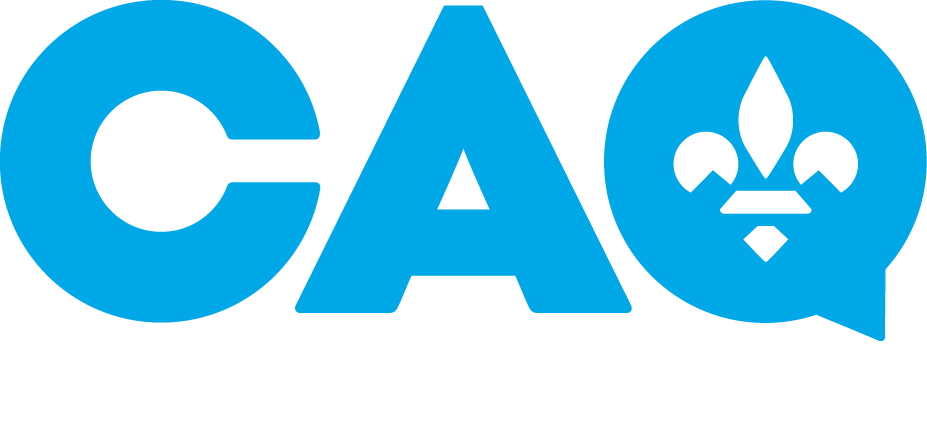Aide pour le bon fonctionnement des institutions muséales
Publié le 17 décembre 2019

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, annonce aujourd’hui, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l’attribution d’une aide financière de 3 261 630 $ pour la période 2019-2022 à 8 institutions muséales situées dans la région du Bas-Saint-Laurent.
L’aide financière est octroyée à ces institutions dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM) qui permet d’appuyer les organismes dans l’accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d’action, notamment par la mise en valeur de leurs collections et thématiques, la diversification de leur programme d’activités éducatives et culturelles et le développement de leur offre aux visiteurs.
« Les musées sont des gardiens de notre identité et de notre mémoire qui alimentent notre fierté collective. Par leur présence dans toutes les régions du Québec, les institutions muséales participent à la vie culturelle citoyenne en démocratisant les arts et la culture. L’aide annoncée aujourd’hui permettra à ces institutions muséales de poursuivre leurs activités et d’offrir à la population des expériences culturelles de qualité. », a mentionné Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.
« Les musées du Québec constituent un secteur d’activité majeur, tant en termes d’investissements publics directs qu’en ce qui concerne les nombreuses retombées économiques et culturelles qu’ils entraînent. Ils représentent également des institutions proches de la population qui valorisent la connaissance, le patrimoine et le développement personnel. Soucieux de permettre à tous l’accès à ces établissements muséologiques qui font la fierté de nos concitoyennes et de nos concitoyens, votre gouvernement estime essentiel d’encourager leur essor dans toutes les régions du Québec. », a déclaré Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
« Je me réjouis du soutien accordé au Musée du Bas-Saint-Laurent, fierté des concitoyennes et des concitoyens de ma circonscription. Cet investissement gouvernemental est une excellente nouvelle pour la population et pour les visiteurs d’un établissement qui les invite à mieux connaître l’évolution des paysages, des artistes et des gens ayant forgé l’âme du Bas-Saint-Laurent, une région où nature et culture se conjuguent en une émouvante harmonie. », a souligné Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata.
Faits saillants :
- Lors du budget gouvernemental 2019-2020, une somme supplémentaire de 15 M$ sur 5 ans était annoncée pour le PAFIM.
- Le 10 mai 2019, le ministère de la Culture et des Communications communiquait les résultats de l’agrément des institutions muséales.
- Le 3 octobre 2019, la ministre de la Culture et des Communications annonçait que les subventions octroyées pour le PAFIM s’élèveraient à 61 M$. Il s’agit d’une aide financière annuelle de 20,3 M$ pour la période 2019-2022, qui comprend une bonification de 3 M$ par an prévue pour les 5 prochaines années. Elle annonçait également qu’elle accordait une enveloppe de 100 000 $ à la Société des musées du Québec pour lui permettre de tracer un portrait actuel de la main-d’œuvre du secteur muséal et de ses enjeux.
- Au total, 96 institutions réparties dans toutes les régions du Québec ont obtenu une aide financière, dont 16 nouvelles qui n’avaient jamais été soutenues dans le passé. Un contexte très positif pour le réseau muséal, puisque les sommes accordées à la majorité des organismes, soit près de 88 % d’entre eux, ont augmenté.
- L’aide financière offerte comporte une aide de base pour la mission de l’organisme et une aide supplémentaire pour la production.
- Le PAFIM compte 2 volets. Le premier reconnaît la contribution des institutions muséales de portée régionale et nationale au développement culturel de leur territoire et leur rôle central dans la conservation et la diffusion du patrimoine. Le second volet réaffirme la responsabilité du Ministère à l’égard des institutions muséales gestionnaires de biens patrimoniaux protégés par la Loi sur le patrimoine culturel et confirme la nécessité de mettre en valeur ces éléments de notre histoire et d’en faciliter l’accès.
- Le processus d’agrément sera ouvert à nouveau à l’hiver 2020 pour les institutions muséales souhaitant faire une demande.
Liens connexes :
Programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales
Agrément des institutions muséales
Liste des institutions muséales soutenues
Musée du Bas-Saint-Laurent
Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
Musée régional de Rimouski
Manoir seigneurial Fraser
Site historique de la maison Lamontagne
Site patrimonial de pêche Matamajaw
Site historique maritime de la Pointe-au-Père
Jardins de Métis