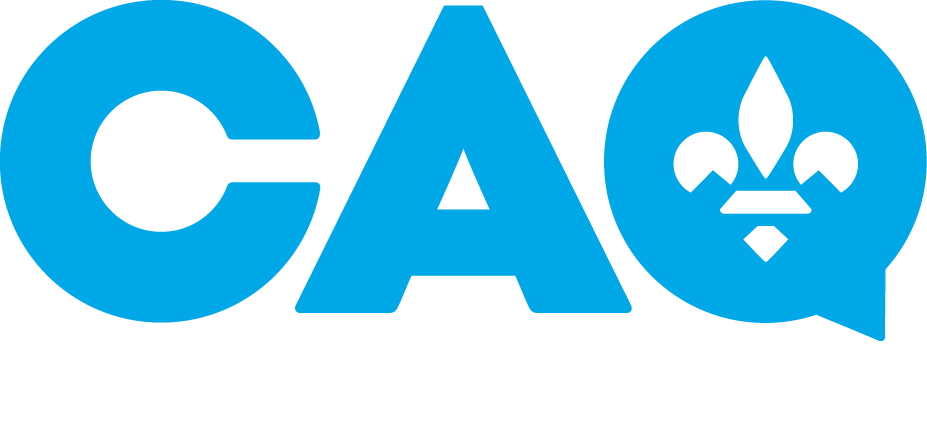Des cancers seront plus facilement reconnus comme des maladies professionnelles
Publié le 11 avril 2025

Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, simplifie la reconnaissance de six cancers à titre de maladie professionnelle pour les pompières et pompiers du Québec, soit le cancer colorectal, la leucémie et les cancers du cerveau, des testicules, de l’œsophage, et du sein.
Les pompières et les pompiers touchés par ces maladies oncologiques bénéficieront de la présomption de maladie professionnelle lors du dépôt de leur réclamation, s’ils satisfont aux conditions particulières énoncées au Règlement sur les maladies professionnelles (RMP) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) pour chaque maladie.
Le règlement visant la modification du RMP a été adopté par le Conseil des ministres le 2 avril 2025. Il entrera en vigueur dans les prochains jours.
Indemnisation plus simple et plus rapide
Avec ces changements, la pompière, le pompier ou son bénéficiaire sont dispensés de démontrer la relation entre la maladie diagnostiquée et son travail. En effet, l’application de la présomption facilite le fardeau de preuve en présumant de la relation de causalité entre la maladie et le travail.
Le traitement de l’admissibilité pour une maladie professionnelle est également simplifié et uniformisé par la présence de conditions particulières, comme la durée d’emploi minimale. Les changements apportent par ailleurs une plus grande cohérence pancanadienne dans la reconnaissance des cancers chez les pompiers.
De son côté, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) estime qu’environ 50 personnes pourraient voir leur maladie professionnelle reconnue et être indemnisées dans les années suivant l’entrée en vigueur des modifications au RMP.
Le RMP résulte de l’adoption de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, le 6 octobre 2021. La création de ce règlement, qui remplace l’ancienne Annexe 1 de la LATMP, permet une plus grande souplesse quant à la modification ou l’ajout à la liste des maladies bénéficiant de la présomption de maladie professionnelle.
Citations
« Ces changements réglementaires étaient nécessaires afin que les pompiers et les pompières du Québec n’aient plus à démontrer la relation entre la maladie diagnostiquée et leur travail. Ces démarches peuvent générer du stress et des inquiétudes, et il est important de mieux soutenir ces travailleuses et ces travailleurs pour alléger leur charge mentale. Toutefois, il reste du chemin à parcourir afin de reconnaître encore plus de cancers liés à la profession de pompier. Votre gouvernement s’engage à poursuivre les travaux pour élargir cette reconnaissance et protéger encore mieux les individus qui risquent leur santé et leur sécurité pour sauver nos vies. »
Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l’Abitibi‑Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec
« En facilitant la reconnaissance d’un plus grand nombre de cancers à titre de maladies professionnelles bénéficiant de la présomption, nous souhaitons offrir aux pompières et aux pompiers un accès plus facile et plus rapide à l’indemnisation et une plus grande tranquillité d’esprit. Nous continuerons à travailler, conjointement avec les parties prenantes concernées, afin d’améliorer la protection de ces travailleuses et de ces travailleurs. »
Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST