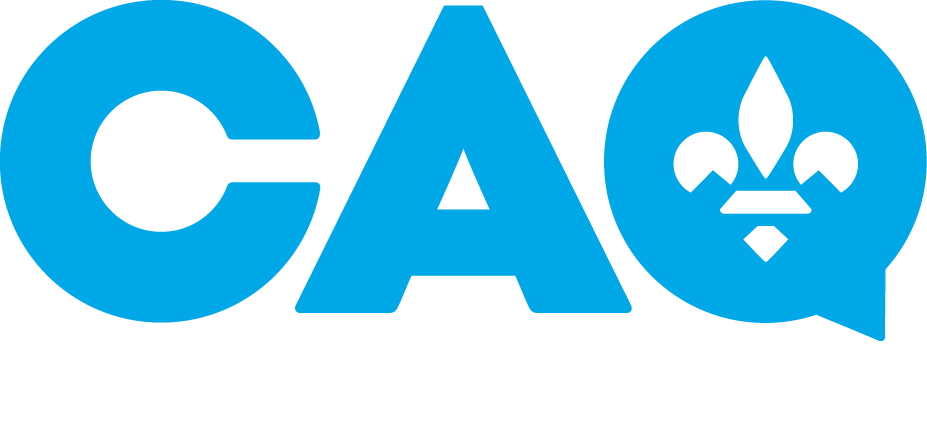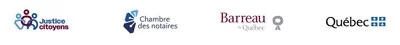Des investissements pour lutter contre l’érosion côtière
Publié le 16 avril 2025

La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, annoncent une aide financière de 1,5 million de dollars pour soutenir trois municipalités nord-côtières dans la réalisation de projets d’adaptation aux effets de l’érosion et de la submersion côtières. Les municipalités visées par cette annonce sont Longue-Pointe-de-Mingan, Natashquan et la Ville de Port-Cartier.
Chacun des projets, subventionné à hauteur de 500 000 $, prévoit la réalisation d’une étude de risques tenant compte des changements climatiques ainsi que l’évaluation de différents scénarios d’adaptation aux aléas côtiers. En considérant les risques actuels et projetés, différentes mesures seront analysées, telles que la protection des berges et des solutions basées sur la nature.
Citations :
« Les changements climatiques posent des défis importants d’aménagement du territoire, en particulier dans les zones côtières, où l’érosion et la submersion menacent directement la sécurité et la vitalité des communautés. Face à ces enjeux, notre gouvernement s’engage résolument pour accompagner les communautés les plus à risque. Grâce à une coordination renforcée entre les ministères et par les actions du Bureau de projets, notre gouvernement est là pour soutenir les municipalités dans leur compréhension des risques et dans l’élaboration de solutions adaptées, durables et structurantes. »
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
« Ces investissements démontrent la volonté de notre gouvernement d’agir de façon proactive face aux impacts grandissants des changements climatiques. Grâce à notre Plan pour une économie verte, nous appuyons les communautés afin qu’elles puissent mieux planifier leur avenir et s’adapter aux réalités côtières, tout en assurant la résilience de leurs milieux de vie. C’est une étape essentielle pour protéger nos territoires, aujourd’hui et pour les générations à venir. »
Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
« De nombreuses communautés de la Côte-Nord nécessitent des stratégies d’adaptation plus efficaces et diversifiées pour faire face aux risques côtiers croissants. Aujourd’hui, je suis fière que notre gouvernement annonce une aide de 1,5 million pour permettre à trois municipalités de Duplessis d’agir de manière proactive et d’être mieux outillées dans leur gestion des risques. C’est important de soutenir celles qui souhaitent mettre en place des mesures concrètes pour atténuer les impacts de l’érosion. »
Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis
« Établi face au golfe du Saint-Laurent et construit sur une fragile pointe de sable, notre village subit les aléas de dame Nature depuis des décennies déjà. Avec l’accélération du réchauffement climatique, les abords côtiers de notre localité s’affaiblissent. Cette importante aide gouvernementale tombe à point. Ainsi, une grande partie des résidences, la plupart de nos entreprises locales et l’usine de transformation des crustacés et poissons se verront rassurées pour les temps à venir. La pérennité et la sécurité de notre cher petit village seront assurées dans ce contexte nord-côtier de plus en plus fragile. »
Ginette Paquet, mairesse de Longue-Pointe-de-Mingan
« C’est avec un immense plaisir que la Municipalité de Natashquan accueille la nouvelle de cet investissement pour le projet d’étude qui permettra d’identifier les risques climatiques et les solutions d’aménagement en vue de résoudre la problématique d’érosion qui touche le noyau villageois de Natashquan. Cela nous permettra de sauvegarder la vitalité socioéconomique de notre municipalité et de protéger les citoyens et leur patrimoine. »
Stéphanie Landry, mairesse suppléante de Natashquan
« Face à l’érosion qui touche le secteur de Pointe-aux-Anglais et son tronçon de la route 138, il est primordial d’agir pour garantir la sécurité des citoyens. Cette étude va nous donner les outils pour trouver une solution durable, en veillant à la sécurité des usagers et à la protection des milieux naturels. La Ville prend ses responsabilités et collabore activement avec ses partenaires pour définir la meilleure approche possible. »
Alain Thibault, maire de Port-Cartier
Faits saillants :
- Les projets retenus résultent de besoins identifiés par le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et certains organismes municipaux dans le cadre de demandes formulées au Bureau de projets en érosion et submersion côtières, coordonné par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
- Le Bureau de projets en érosion et submersion côtières joue un rôle clé en renforçant le soutien aux organismes municipaux. Il offre un accompagnement complémentaire aux programmes gouvernementaux existants.
Liens connexes :
Plan de mise en œuvre 2024-2029 du Plan pour une économie verte 2030
Bureau de projets en érosion et submersion côtières
Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :
- facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation
- x.com/MAMHqc
- linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation
Découvrez les communiqués officiels pour chaque région :