Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice, Mme Kariane Bourassa, et Investissement Québec annoncent l’octroi de 34 millions de dollars pour appuyer la construction et l’exploitation d’une usine écoresponsable de galvanisation à chaud à Saint-Urbain, dans Charlevoix. Ce projet de l’entreprise Galv-Éco, évalué à 77 millions de dollars, devrait créer 95 emplois de qualité dans la région.
Hautement automatisée et à la fine pointe de la technologie, l’usine écoresponsable, d’une superficie de 155 000 pieds carrés, sera dotée du plus grand bassin de trempage au zinc du Canada et pourra traiter annuellement 50 000 tonnes de métaux. Elle sera alimentée à la biomasse forestière, et la galvanisation à chaud s’effectuera grâce à un chauffage à l’hydroélectricité, une première en Amérique du Nord. Cette approche permettra une réduction de 19 000 tonnes d’équivalent CO2 par an comparativement à une usine fonctionnant au combustible fossile. La mise en service de l’usine de Galv-Éco est prévue au début de l’année 2026.
La galvanisation à chaud est un moyen efficace, durable et économique de protéger les métaux contre la rouille. On trouve des produits issus de ce procédé dans la vie de tous les jours : lampadaires, clôtures, boulons, etc.
L’implantation de l’entreprise manufacturière offrant des emplois bien rémunérés est une excellente nouvelle pour la région, qui dépend actuellement beaucoup du tourisme. L’arrivée d’une telle usine représentera un moteur économique pour la collectivité et contribuera à la rétention de main-d’œuvre en région.
Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais nécessaire d’investir dans l’automatisation, l’innovation durable et la productivité des entreprises québécoises pour les rendre plus attrayantes et compétitives dans les secteurs stratégiques, comme ceux de l’acier et de la métallurgie.
Citations :
« Ce fantastique projet écoresponsable stimulera le développement économique de la Capitale-Nationale, tout en répondant à la demande croissante des entreprises pour des services de galvanisation. Je tiens à féliciter l’équipe de Galv-Éco pour la mise en œuvre de cette usine innovante, qui aura des retombées positives sur notre communauté et qui contribuera à améliorer sa qualité de vie. »
Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
« Charlevoix a besoin de projets de la sorte pour diversifier son économie et offrir des emplois de qualité à sa population. L’implantation de l’usine de Galv-Éco viendra dynamiser notre secteur manufacturier, en plus d’agir comme un moteur économique et de contribuer à la rétention de la main-d’œuvre ici. Je salue la décision de notre gouvernement de soutenir ce projet d’investissement, qui donnera un nouveau souffle à l’économie de notre région. »
Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice
« Je salue la vision de Galv-Éco, qui misera sur l’automatisation de sa chaîne de production pour accroître sa productivité tout en exploitant des sources d’énergie propre pour fonctionner. Notre gouvernement est fier d’investir dans des entreprises québécoises, en région, pour stimuler l’économie. »
Christine Fréchette, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional
« La transition vers une économie plus verte repose sur des initiatives concrètes comme celle de Galv-Éco, qui privilégiera des sources d’énergie renouvelable et des procédés novateurs pour faire fonctionner sa future usine. Par cet appui financier, notre gouvernement réaffirme son engagement à accompagner les entreprises dans l’adoption de solutions durables, en cohérence avec son Plan pour une économie verte 2030. »
Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
« En soutenant l’arrivée de Galv-Éco, Investissement Québec démontre son rôle moteur dans la croissance économique régionale, mais aussi l’importance de développer des solutions industrielles écoresponsables. Cette nouvelle usine vient renforcer la filière québécoise de l’acier, tout en générant des retombées économiques positives pour la région de Charlevoix. »
Bicha Ngo, présidente-directrice générale d’Investissement Québec
« Cet investissement sous forme de prêts témoigne de la confiance du gouvernement envers Galv-Éco et confirme toute l’importance de miser sur l’innovation pour dynamiser et diversifier notre économie régionale. Depuis le premier jour, notre objectif est de construire une usine qui deviendra un modèle à l’échelle internationale, tant par son approche écoresponsable que par la qualité des emplois et de l’environnement de travail, en plus d’offrir une solution différente dans un secteur névralgique pour les entreprises d’ici. »
Charles Simard, directeur général de Galv-Éco
Faits saillants :
- L’annonce a été faite au nom de la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, et du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette.
- Le procédé de galvanisation à chaud, en forte demande, consiste à recouvrir une pièce métallique d’une fine couche de zinc en vue de lui conférer une protection anticorrosive.
- Le soutien financier administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement dans le cadre du programme ESSOR se répartit comme suit : 10 millions de dollars sont accordés sous forme de prêt et 5 millions sous forme de débenture.
- Investissement Québec intervient également dans le projet depuis ses fonds propres, à hauteur de 10 millions de dollars.
- De plus, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs verse une subvention de près de 9 millions de dollars à l’entreprise, soit 5 347 625 $ par l’entremise du programme ÉcoPerformance et 3 679 435 $ via le programme Bioénergies.
- Ces programmes, qui découlent du Plan pour une économie verte 2030, appuient des projets d’efficacité et de conversion énergétiques dans les secteurs institutionnel, municipal et des affaires.
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie sur les réseaux sociaux :
Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

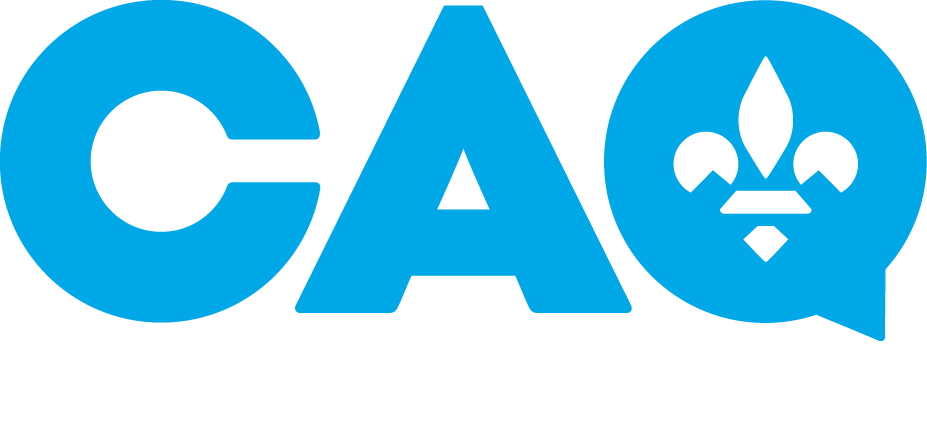



 Source : Vitor Munhoz / Club de hockey Canadien Inc.
Source : Vitor Munhoz / Club de hockey Canadien Inc.



