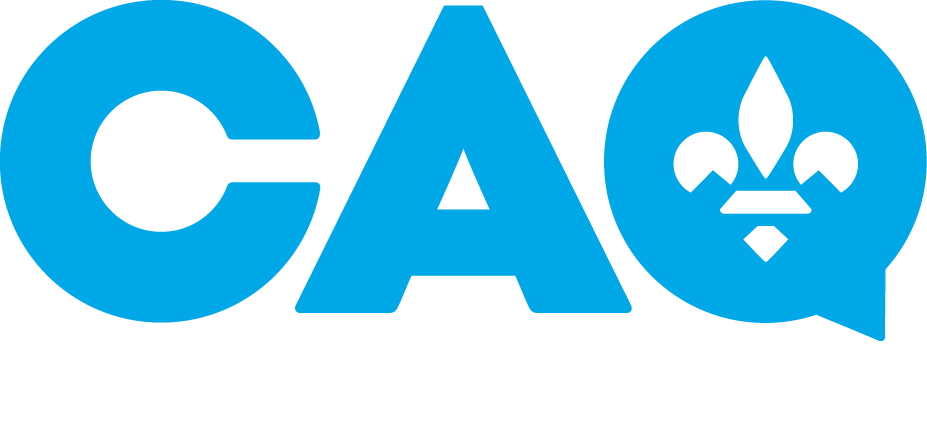Plus de 178 M$ pour le transport en Mauricie
Publié le 16 mai 2025
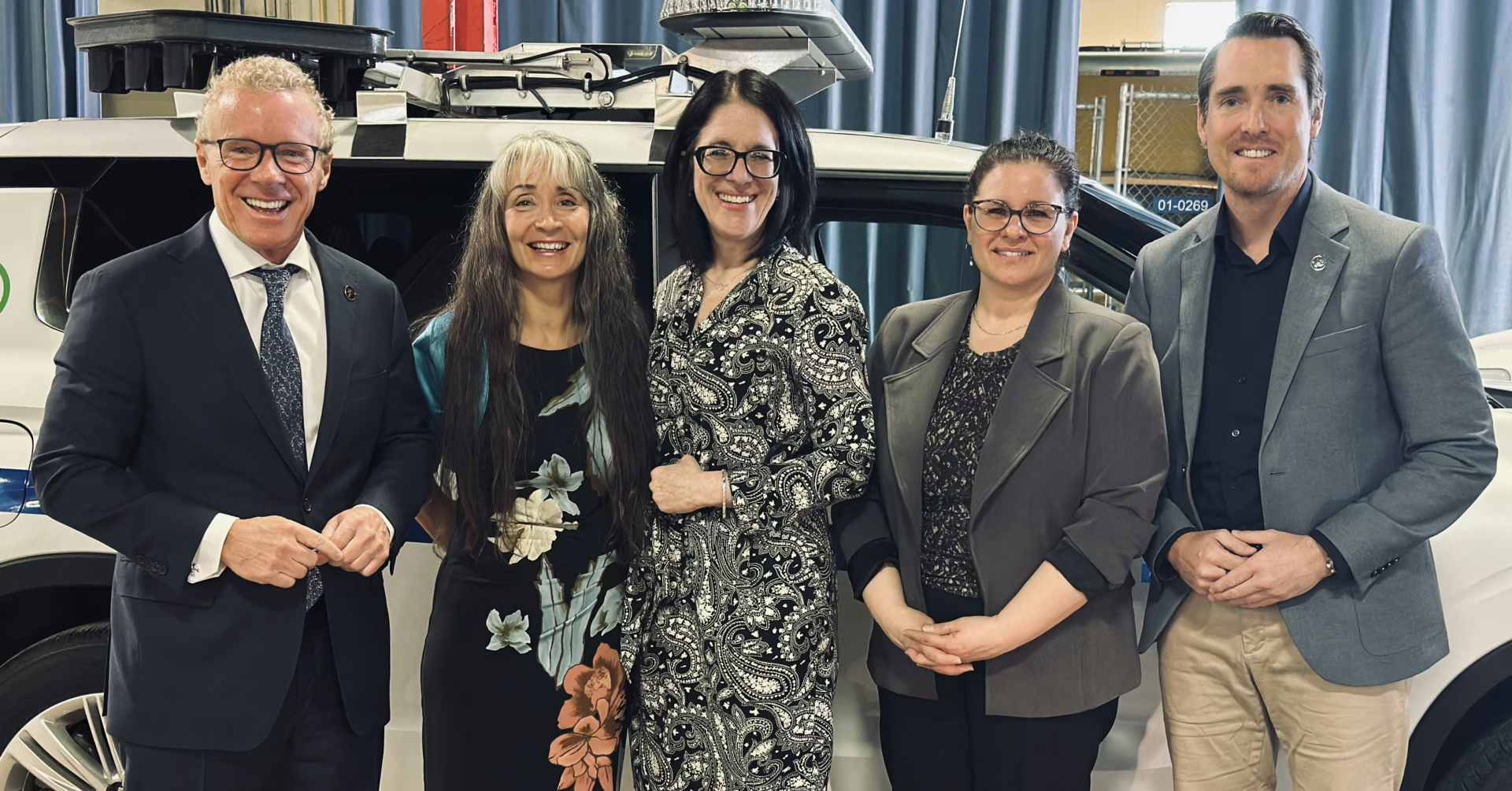
Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, a annoncé un investissement de 178 088 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région la Mauricie.
Pour l’occasion, le ministre était accompagné de la ministre responsable de l’Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, du député de Maskinongé, M. Simon Allaire, et de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif.
Cette année marquera la fin de deux projets d’envergure en Mauricie, soit le remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette et la construction du nouveau pont des Piles, à Shawinigan. De plus, les sommes octroyées permettent la réalisation de projets significatifs, tels que :
- l’asphaltage de la route 155, sur près de 10 km, à La Tuque;
- la réfection du pont situé sur la route Gérin, au-dessus de la rivière Maskinongé, à Sainte-Ursule et à Saint-Justin;
- la poursuite du programme d’intervention sur les ponceaux qui permettra cette année le remplacement de 60 d’entre eux sur le territoire de la Mauricie.
Citations
« Depuis 2018, notre gouvernement fait le choix d’investir toujours plus dans nos infrastructures, notamment en transport, pour rattraper le sous-investissement des gouvernements précédents, et offrir des infrastructures de qualité aux Québécois. Dans le contexte d’imprévisibilité économique que nous vivons actuellement, ce choix s’avère particulièrement judicieux, puisque chaque chantier crée des emplois, fait vivre nos entreprises, notamment celles visées par les tarifs américains, et stimule l’économie dans toutes les régions du Québec. Qui plus est, une des meilleures façons d’aider nos industries à demeurer compétitives à travers cette transition vers de nouveaux marchés et une économie redéfinie, c’est de leur offrir des conditions logistiques optimales, soit des réseaux de transport efficaces. Investir autant est donc un choix ambitieux, mais extrêmement stratégique pour nos citoyens et notre économie! »
Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable
« Les projets qui se concrétiseront grâce aux sommes annoncées aujourd’hui permettront d’assurer des déplacements sécuritaires et fluides à travers notre région. Ces différents chantiers en activité auront pour résultat d’améliorer directement la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens, de même que la vitalité socioéconomique de la Mauricie, notamment par la création d’emplois de qualité. »
Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières
« Plusieurs projets d’asphaltage sont prévus pour l’ensemble des secteurs de la circonscription de Champlain. Les travaux de réfection annoncés pour améliorer les routes, les ponts et les ponceaux permettront de rendre les déplacements des citoyens plus sécuritaires. Je tiens à souligner la collaboration des municipalités et les remercie de leur implication dans l’organisation de ces différents chantiers. »
Sonia LeBel, ministre responsable de l’Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain
« La réfection du pont Gérin et le rehaussement de la route 349 sont des exemples concrets des projets qui, grâce aux investissements de notre gouvernement, amélioreront la sécurité des usagers. Ces travaux soutiennent activement la vitalité économique et sociale de nos municipalités rurales. »
Simon Allaire, député de Maskinongé
« L’été 2025 marquera la fin d’un chantier important dans ma circonscription, soit celui de la reconstruction du pont des Piles, à Shawinigan. De plus, les opérations de pavage sont toujours appréciées sur la route 155, en raison de la circulation de nombreux véhicules lourds. Des travaux sont prévus entre les kilomètres 85 et 95 au cours de la prochaine année. Merci à la direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour cette programmation dynamique qui rehaussera la sécurité de nos routes et de nos autoroutes ! »
Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice
Faits saillants
- Les sommes investies dans la région de la Mauricie se répartissent comme suit :
- 39 287 000 $ pour améliorer l’état des chaussées;
- 126 368 000 $ pour améliorer l’état des structures;
- 12 433 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire.
- En 2024, plusieurs projets ont été terminés, dont :
- l’asphaltage des autoroutes 40 et 55 sur près de 19 km, à Trois-Rivières, à Sainte-Étienne-des-Grès, à Champlain, à Saint-Luc-de-Vincennes et à Saint-Maurice;
- la reconstruction du pont situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste Nord, au-dessus de la rivière Yamachiche, à Charrette;
- la stabilisation du talus du chemin de la rivière Croche, à La Tuque, au kilomètre 13.