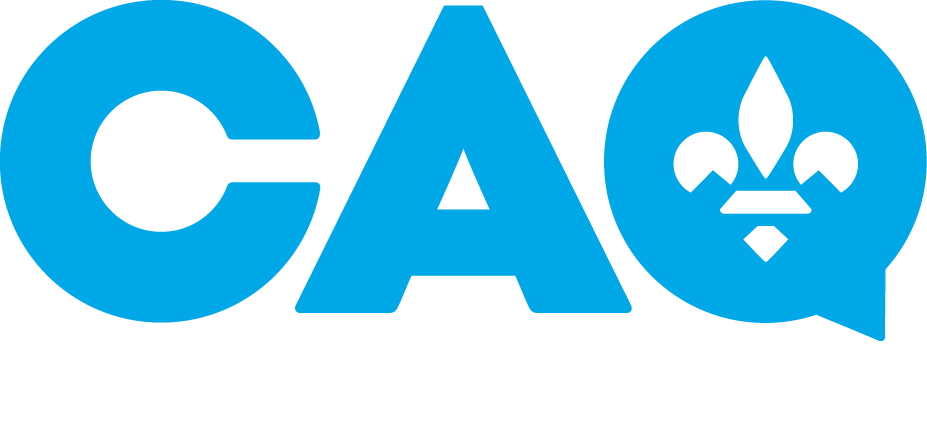Adoption du projet de loi 83 : Québec protège l’accès au réseau public
Publié le 24 avril 2025

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a adopté aujourd’hui le projet de loi 83 favorisant la pratique de la médecine dans le réseau public au Québec. Ce projet agit sur deux volets : d’une part, les nouveaux médecins devront pratiquer dans le réseau public québécois les cinq premières années après leurs études ; d’autre part, tous les médecins devront obtenir une autorisation de Santé Québec afin de pratiquer au privé, selon certains critères précis. L’adoption de ce projet de loi s’inscrit dans les nombreux changements réalisés depuis trois ans prévus au Plan santé. C’est un geste de plus pour améliorer concrètement l’accès aux soins pour l’ensemble des Québécois.
Les nouveaux médecins devront pratiquer au moins cinq ans dans le réseau public québécois après leurs études
Puisque les Québécois investissent massivement pour former plus de médecins au Québec, ce projet de loi fait en sorte que les nouveaux médecins doivent pratiquer au sein du réseau public québécois les cinq premières années après leurs études. Rappelons qu’une sanction financière sera imposée afin de dissuader les nouveaux médecins qui voudraient exercer au privé ou hors du Québec sans préalablement respecter leur engagement. Ces dispositions entreront en vigueur dès la sanction du projet de loi.
Des critères précis pour freiner l’exode vers le privé et baliser les allers-retours des médecins entre le public et le privé
En mettant en place des critères précis pour permettre aux médecins de quitter le réseau public et de travailler pour le privé, le projet de loi 83 vise à préserver l’accès au réseau public pour l’ensemble des Québécois. Un régime d’autorisation sera désormais géré par Santé Québec, permettant d’évaluer les demandes des médecins désirant travailler au privé. Rappelons que, jusqu’à présent, aucune autorisation n’avait à être fournie aux médecins, ceux-ci ne devant qu’informer la RAMQ à l’intérieur de certains délais. Ainsi, depuis le dépôt des amendements le 1er avril, un encadrement plus rigoureux a été mis en place afin de mieux protéger l’intérêt des patients. Des critères précis guideront désormais les autorisations accordées, notamment :
- la présence d’un nombre suffisant de médecins dans les établissements publics de la région du ou de la médecin;
- l’absence de conséquences négatives pour les patients de sa région;
- l’incapacité du réseau public de mettre à contribution ce médecin dans les établissements de sa région.
Citations :
« Notre gouvernement prend des mesures concrètes pour améliorer l’accès aux soins de santé, avec un objectif clair : que tous les Québécois soient pris en charge d’ici l’été 2026. Le système de santé universel, financé par la population québécoise, doit permettre à chacun de consulter un médecin quand il en a besoin, simplement grâce à sa carte Soleil. Le privé peut contribuer à soutenir le réseau public : nous veillerons à ce que cette contribution demeure complémentaire, toujours dans l’intérêt des patients québécois. »
Christian Dubé, ministre de la Santé
« Je suis très heureuse de l’adoption de ce projet de loi. En encadrant la pratique privée pour les médecins et en instaurant l’engagement de cinq années de service au profit du réseau public pour les nouveaux médecins, nous nous donnons les moyens d’offrir à la population un réseau de santé efficace. C’est un geste de plus posé par notre gouvernement qui aura des retombées positives concrètes sur l’accès aux soins pour les Québécois. »
Catherine Blouin, députée de Bonaventure et adjointe parlementaire au ministre de la Santé
Faits saillants :
- Soulignons que, dans les trois derniers mois, près de 60 médecins de plus se sont désaffiliés du réseau public, et ce, en plus des 150 médecins, dont 145 spécialistes, qui ont alterné dans la dernière année entre le réseau privé et public.
- Rappelons de plus que les données les plus récentes démontrent que, parmi les 22 868 médecins au Québec, plus de 835 travaillent dans le réseau privé actuellement, ce qui représente une hausse de plus de 80 % par rapport à pareille date en 2020.
- Mentionnons que le projet de loi a fait l’objet d’amendements à la suite de consultations particulières qui ont permis de l’améliorer et de mettre en place le régime d’autorisation.
- Rappelons enfin que le projet de loi vise à mettre en place le régime d’autorisation pour une période de deux ans.